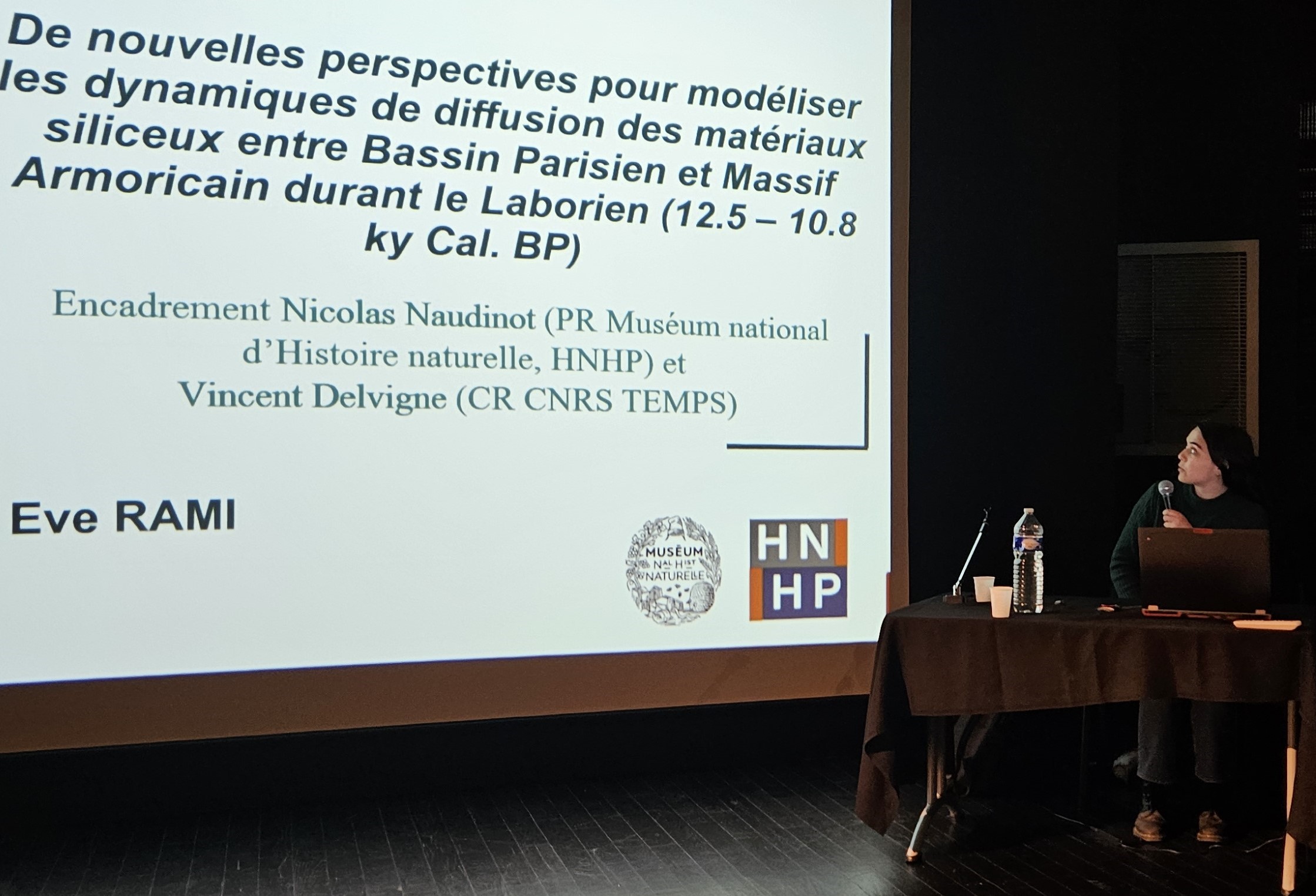Trois thèses à C'Chartres Archéologie
En 2025, C’Chartres Archéologie accueille trois doctorantes au sein de ses locaux. Lilas Monti, Audrey Pilon et Ève Rami sont toutes trois chercheuses, mais se spécialisent chacune dans des domaines et des périodes distinctes. Ensemble, elles traversent les époques et réfléchissent aux modes d’organisations des multiples populations qui ont peuplées Chartres et ses alentours. Découvrez leur travail !
Lilas Monti est encadrée par Anne Nissen, Professeure d'archéologie médiévale à l’Université Panthéon-Sorbonne, Mark Guillon, anthropologue à l’Université de Bordeaux, et Émilie Portat archéo-anthropologue et maître de conférences à l’Université Panthéon Sorbonne. Sa thèse porte sur le sujet suivant : « Pas de deux entre la ville et ses morts. Approche anthropobiologique des interactions entre le tissu urbain et le paysage funéraire du Ve au XIIIe siècle. Enquête transdisciplinaire. »
Lilas concentre ainsi ses recherches sur le haut Moyen Âge, et cherche à comprendre comment s’articule le rapport aux morts et à la mort à cette période, dans un espace urbain en pleine évolution. Elle réfléchit notamment à la façon dont la gestion de la mort passe de la famille à l'Eglise, et quels sont les gestes funéraires qui les accompagnent.
Elle croise ainsi approche anthropobiologique et approche géographique afin d’étudier des sites chartrains comme le site de la Courtille fouillé de 2010 à 2012 et la rue du Bourgneuf fouillée entre 2016 et 2017, mais également des sites de Bourges et d’Orléans.
Lilas Monti / Sépultures retrouvées sur le site du Bourgneuf
Audrey Pilon mène quant à elle sa thèse à l’EPHE (École Pratique des Hautes Études) à Paris et est dirigée par William Van Andringa, archéologue et directeur d'études à l’EPHE. Elle a pour sujet « De l’homo faber à l’homo detritus : étude archéologique et historique des rejets urbains à Chartres et à Pompéi dans l’Antiquité ».
Par ce travail, Audrey se concentre sur la gestion des déchets et particulièrement les rejets en céramique à la période antique, et contextualise ainsi son travail autour de deux notions : l’espace et le geste/la pratique. Elle cherchera donc à caractériser les espaces de rejet (dépotoir, épandage, ou pas) et à comprendre comment ces déchets sont rejetés, en adoptant une méthode céramologique et biographique. Cette méthodologie passe par l’identification des traces sur la céramique ainsi que par l'étude de la répartition spatiale de celle-ci, notamment grâce à l’étape du collage (restitution et collage des tessons de céramique entre eux) quand cela est possible.
En parallèle d'une étude des déchets céramiques dans différents secteurs de la ville de Pompéi, elle étudie également le site de la Courtille et celui de l’actuel cinéma, deux fouilles majeures qui ont respectivement eu lieu de 2010 à 2012 et de 2006 à 2011, à Chartres.
Audrey Pilon / Épandage sur une parcelle du site de la Courtille
Ève Rami, elle aussi chercheuse, a débuté une thèse au MNHN (Muséum national d'Histoire naturelle (UMR 7194 HNHP)) sous la direction de Nicolas Naudinot et Vincent Delvigne (CNRS) à Paris. Elle développe une recherche croisant géologie et archéologie : « De nouvelles perspectives pour modéliser les dynamiques de diffusion des matériaux siliceux entre le Bassin Parisien et le Massif Armoricain durant le Laborien[1] ».
Entre prospection sur le terrain et analyse des données au sein des bureaux de C’Chartres Archéologie, elle propose une réflexion autour du silex, matériau largement exploité à la Préhistoire, et de sa collecte parmi différents sites étudiés. Avec une approche géographique, elle souhaite comprendre et faire des liens entre gîtes à silex et sites archéologiques. Ève cherche ainsi à savoir si les différents sites archéologiques qu’elle va être amenée à étudier avaient des sources d’approvisionnement en matière première (ici le silex) similaires ou non, et en quelle quantité.
Cela lui permettra finalement de mieux comprendre les réseaux et habitudes d’approvisionnement des populations qui ont pu occuper ces sites à la période du Laborien. Parallèlement, ses recherches apporteront de nouvelles données sur les matières premières dans la région Centre, contribuant ainsi à enrichir Cartosilex.fr, un site accessible à tous qui recense tous les gîtes à silex en France.
Ève Rami / Échantillons géologiques tirés de gîtes à silex
[1] Le Laborien est la toute dernière période du Paléolithique supérieur, juste avant l’entrée dans le mésolithique et la période interglaciaire. Ses bornes chronologiques se situent entre 12 500 et 10 800 ans avant le présent.